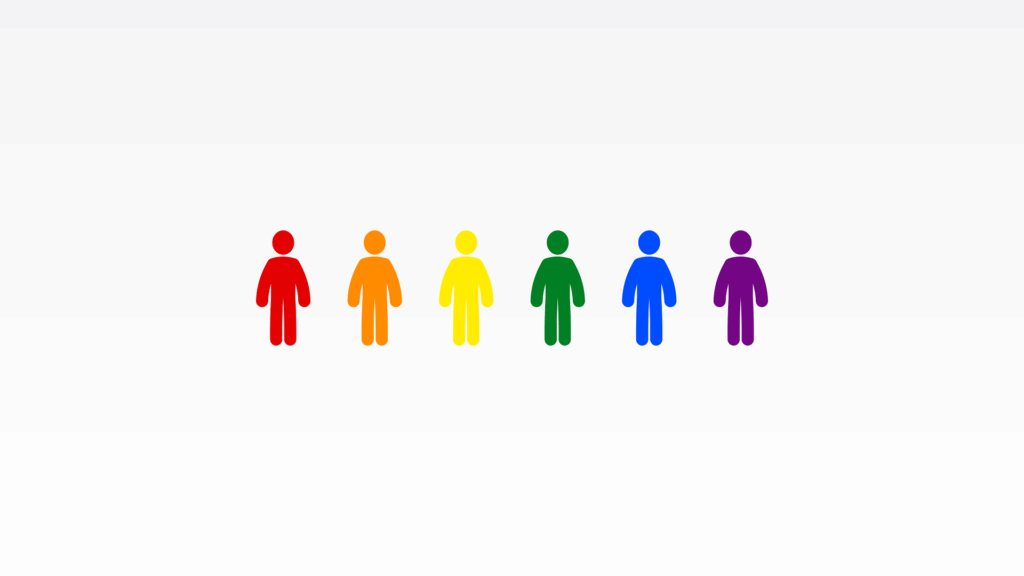
Friedrich Hayek considérait que l’État de droit était essentiel pour réduire au minimum la coercition et renforcer la liberté individuelle. Dans ce contexte, il considérait «l’égalité devant la loi» (égalité formelle) comme essentielle à l’État de droit. Cependant, il soulignait que l’égalité formelle était le seul concept d’égalité compatible avec l’État de droit. Il critiquait les tentatives socialistes et progressistes de théoriser d’autres notions d’égalité, présentées sous le nom de «justice sociale», qu’il considérait comme des attaques déguisées contre la liberté. Dans La Constitution de la liberté, il explique :
«L’égalité en matière de règles générales de droit est la seule forme d’égalité propice à la liberté et la seule que nous puissions atteindre sans compromettre la liberté. La liberté n’a pas seulement rien à voir avec les autres formes d’égalité, elle est même vouée à produire des inégalités à bien des égards. C’est là le résultat nécessaire et une partie de la justification de la liberté individuelle : si le résultat de la liberté individuelle ne démontrait pas que certains modes de vie sont plus efficaces que d’autres, une grande partie de son bien-fondé disparaîtrait».
À l’instar de Ludwig von Mises, Hayek défendait la liberté en arguant que la liberté individuelle est essentielle à la civilisation occidentale — il la décrivait comme «l’idéal de liberté qui a inspiré la civilisation occidentale moderne et dont la concrétisation partielle a rendu possibles les réalisations de cette civilisation». Il serait absurde pour quiconque apprécie cette civilisation de saper la liberté même qui lui permet de s’épanouir. Tenter d’éradiquer l’inégalité tout en prétendant valoriser les conditions qui l’ont engendrée serait contradictoire.
Pour Hayek, l’égalité formelle ne repose pas sur l’égalité essentielle des êtres humains, mais sur l’idéal de liberté. Il met en garde contre le fait que :
«Nous ne devons pas oublier que les individus sont très différents dès le départ… Il n’est tout simplement pas vrai que tous les hommes naissent égaux».
L’égalité formelle ne repose pas sur le principe que les individus sont égaux : c’est précisément parce que les individus ne sont pas égaux que la loi leur garantit la protection égale conférée par l’État de droit. La loi nous assure que, riches ou pauvres, grands ou petits, noirs ou blancs, nous sommes tous soumis aux mêmes règles. Comme Hayek le dit :
«L’égalité formelle reconnaît non seulement reconnaît que les individus sont très différents, mais repose dans une large mesure sur cette hypothèse. Elle insiste sur le fait que ces différences individuelles ne justifient en rien que le gouvernement les traite différemment».
Dans un État de droit, les différences innées entre les individus sont considérées comme sans importance, d’où la référence classique à la «justice aveugle». Le principe de la justice aveugle ne signifie pas que les différences n’existent pas, mais que la loi n’en tient pas compte. Ainsi, Hayek souligne que l’égalité devant la loi «ne présuppose pas que les individus soient égaux [et] ne cherche pas à les rendre égaux». Il ajoute :
«Rien n’est toutefois plus préjudiciable à l’exigence d’égalité de traitement que de la fonder sur une hypothèse aussi manifestement fausse que celle de l’égalité factuelle de tous les individus. Fonder l’égalité de traitement des minorités nationales ou raciales sur l’affirmation qu’elles ne diffèrent pas des autres individus revient implicitement à admettre que l’inégalité factuelle justifierait une inégalité de traitement ; et la preuve que certaines différences existent bel et bien ne tarderait pas à être apportée. L’essence même de la demande d’égalité devant la loi est que les personnes doivent être traitées de la même manière malgré leurs différences».
En d’autres termes, affirmer que les personnes sont traitées de manière égale parce qu’elles sont effectivement égales impliquerait que si elles n’étaient pas égales, elles ne devraient pas être traitées de manière égale. Or, le principe même de l’État de droit est de régir tout le monde selon les mêmes règles générales, malgré les différences individuelles. Il s’ensuit que l’État de droit ne se mesure pas à l’aune de l’égalité effective des personnes, mais à celle de l’application des règles de la même manière à tous. Le pouvoir de l’État est limité par l’obligation de traiter tous les citoyens de la même manière. Il serait absurde de dire que la manière dont l’État doit traiter tous les citoyens de la même manière consiste à traiter les personnes différemment afin qu’elles finissent toutes par être égales. C’est là le défaut fondamental des théories juridiques critiques qui espèrent que tous les groupes de personnes finiront par être «égaux» après l’élimination de toutes les inégalités.
La défense de l’État de droit par Hayek s’adresse en grande partie à ceux qui ne partagent pas sa préférence morale pour la liberté. Il fait donc appel à la raison et à la rationalité en soulignant le rôle de la liberté dans l’épanouissement de la société. Il n’accorde pas beaucoup d’importance à la loi naturelle ou au concept de libre arbitre pour justifier la liberté, observant que «l’affirmation selon laquelle la volonté est libre semble avoir aussi peu de sens que sa négation, et que toute cette question est un problème théorique, une querelle de mots dans laquelle les adversaires n’ont pas précisé ce qu’impliquerait une réponse affirmative ou négative». Il ne voit pas non plus quoi que ce soit de «naturel» dans les droits de propriété, observant qu’il n’est pas clair «ce qui doit exactement être inclus dans cet ensemble de droits que nous appelons «propriété»… Il n’y a rien de «naturel» dans une définition particulière de ce type de droits».
Au contraire, comme Mises, il souligne le fait que peu de gens peuvent affirmer de manière crédible accorder une telle importance à l’égalité qu’ils sont prêts à renoncer à leur liberté et à détruire la civilisation pour parvenir à une société plus égalitaire. Dans la plupart des cas, ceux qui prétendent vouloir un compromis entre égalité et liberté espèrent simplement pouvoir concilier les contradictions mises en évidence par Hayek. Ils supposent qu’ils seraient tout à fait disposés à renoncer à un peu de liberté si cela leur permettait d’obtenir un peu plus d’égalité. Mais Hayek démontre que cette attente est malheureusement erronée. Il rejette toutes les revendications de «justice sociale», non seulement parce que les problèmes de connaissance qu’il met en évidence rendraient impossible la réalisation des compromis attendus, mais surtout parce que son objectif est de maximiser la liberté en minimisant la coercition. Toute tentative d’égalisation des personnes irait à l’encontre de cet objectif et serait en fait «le contraire de la liberté». On ne peut pas renforcer la liberté en la détruisant.
La liberté conduit inévitablement à l’inégalité, car les individus sont fondamentalement différents. Par exemple, si un athlète qui s’entraîne plus que les autres a plus de chances de gagner une course, ceux qui souhaitent égaliser les performances de tous les coureurs doivent s’assurer que personne n’est libre de s’entraîner plus que les autres et que ceux qui ont besoin de rattraper leur retard bénéficient d’une aide spéciale pour leur entraînement. Hayek explique que «la seule façon de les placer dans une position égale serait de les traiter différemment». C’est le principe qui sous-tend des programmes tels que la discrimination positive, la diversité, l’égalité et l’inclusion : traiter les individus différemment afin d’égaliser leur position, ce que Hayek appelle «l’égalité matérielle». Ainsi, Hayek explique :
«L’égalité devant la loi et l’égalité matérielle ne sont donc pas seulement différentes, elles sont en conflit l’une avec l’autre ; et nous pouvons atteindre l’une ou l’autre, mais pas les deux à la fois. L’égalité devant la loi qu’exige la liberté conduit à l’inégalité matérielle».
Contrairement à Mises et Rothbard, Hayek accepte que «la fiscalité et les divers services obligatoires, en particulier dans les forces armées» puissent jouer un rôle dans un État de droit. Il soutient que, bien que coercitifs, ces services sont atténués par leur caractère «prévisible» et «aussi indépendant de la volonté d’autrui que les hommes ont appris à l’être dans la société». Il admet également que des interventions de l’État peuvent être nécessaires pour protéger les individus contre la coercition d’autrui. Cependant, Hayek n’accepte pas que la coercition étatique soit requise pour rendre les individus égaux : «le désir de rendre les individus plus semblables dans leur condition ne peut être accepté dans une société libre comme justification d’une coercition supplémentaire et discriminatoire». Selon lui, le désir d’égalisation est motivé par la simple envie, «le mécontentement que le succès de certains suscite souvent chez ceux qui réussissent moins bien». L’État n’a aucun rôle à jouer dans la promotion du vice destructeur qu’est l’envie.
Comme le savent certains lecteurs, Rothbard a critiqué certains aspects clés de la philosophie de la liberté de Hayek, en particulier ses «positions compromettantes et intenables» en matière de fiscalité, de conscription et d’autres interventions de l’État, ainsi que son «rejet brusque et cavalier de toute la théorie du droit naturel». En ce qui concerne le rejet de l’égalité matérielle, Rothbard n’était pas convaincu que les revendications socialistes en matière de «justice sociale» pouvaient être rejetées comme dénuées de sens et en déclarant que leurs partisans étaient simplement envieux des autres. Il peut parfois arriver que des personnes considèrent sincèrement l’inégalité comme injuste, non pas parce qu’elles sont envieuses, mais parce qu’elles croient sincèrement (même si, comme le montre Rothbard, à tort) aux théories marxistes du conflit de classes et de l’exploitation des pauvres. Selon Rothbard, une théorie de la justice est donc nécessaire pour répondre aux affirmations selon lesquelles l’inégalité est injuste, et il soutient qu’une telle théorie trouve son meilleur fondement dans les principes de droit naturel que sont l’autodétermination et la propriété privée.
L’Institut Libéral se réjouit d’avoir de vos nouvelles.
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 364 16 66
institut@libinst.ch
INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Tel.: +41 (0)21 510 32 00
liberal@libinst.ch
ISTITUTO LIBERALE
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
liberale@libinst.ch

Recevoir environ une fois par mois des informations sur les publications et événements du moment.