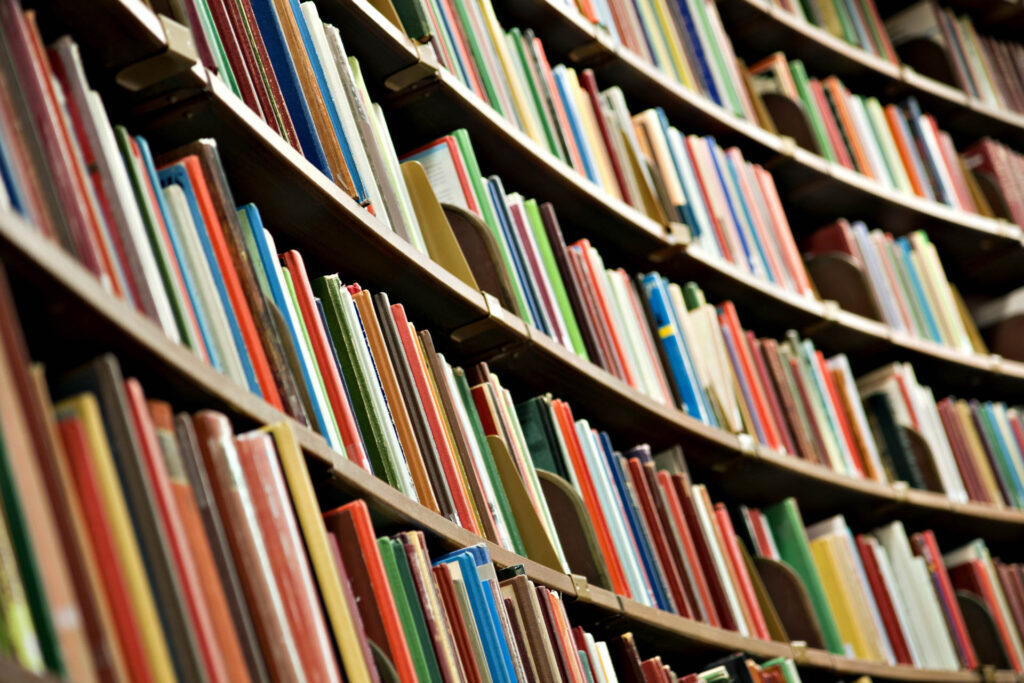
Charles Monnard, personnage fascinant qui fut à la fois théologien, professeur de littérature, journaliste, historien, mais aussi homme politique et philosophe, fait partie des figures marquantes du libéralisme suisse. Le vernissage, le 26 mai à Lausanne, des actes du colloque organisé fin novembre 2013 sous l’égide du Cercle démocratique de Lausanne en partenariat avec l’Institut Libéral, et en collaboration avec le Cercle littéraire et la Société de Belles-Lettres, est revenu sur certains des aspects de sa vie et de son œuvre, en présence de quelque 70 personnes.
Le parcours de Charles Monnard s’inscrit dans le développement du libéralisme lémanique au dix-huitième et au dix-neuvième siècles, lorsque les idées des Lumières se diffusent avec une intensité sans parallèle. Comme l’a rappelé l’historien Olivier Meuwly, directeur de la publication, l’enjeu consistait à trouver le système le plus susceptible de protéger les libertés individuelles, tout en servant l’ambition d’une Suisse plus unie, précisément autour de la valeur de la liberté. Dans le canton de Vaud, puis au niveau fédéral, Charles Monnard prolonge l’engagement de son ami et mentor Frédéric-César de la Harpe, lecteur de Destutt de Tracy, de Jean-Baptiste Say et de Benjamin Constant. Monnard va s’emparer de la question de la liberté de la presse pour en faire un étendard de sa lutte pour la liberté, notamment à travers la publicité des débats parlementaires. Il critique également les indemnités aux députés. Le libéralisme inspire son œuvre d’historien: la Suisse est pensée comme le pays dans lequel s’est réellement épanouie la liberté, dans la durée, et en appui des institutions démocratiques. Monnard ne peut néanmoins être appréhendé sans comprendre la doctrine théologique individualiste du protestantisme, qui appelle une liberté de pensée et de conviction, un thème également cher à son allié Alexandre Vinet. Finalement, Charles Monnard se redécouvre dans l’ambiance culturelle éclairée de la vie académique, ainsi qu’à travers les luttes politiques qui marquèrent son époque.
Dans un hommage idéel, Pierre Bessard, directeur de l’Institut Libéral et auteur de l’essai primé Charles Monnard, l’éthique de la responsabilité, a souligné la signification actuelle du message kantien de Monnard. La notion de devoir, que l’on retrouve aussi chez Benjamin Constant, est une obligation non pas imposée par une autorité, mais librement consentie, sur la base de la conscience morale de la personne. Elle décrit le pendant de la liberté, la responsabilité individuelle, et en société, l’éthique de la réciprocité, l’égalité en droit, mais aussi la bonne foi et la bonne volonté — dont dépend la société libre. L’État, c’est-à-dire le monopole de la force, ne joue tout au plus qu’un rôle subsidiaire à la culture morale, qui découle bien sûr pour Monnard des sagesses judéo-chrétiennes. C’est particulièrement vrai dans le domaine de la charité, où l’État-providence s’est non seulement substitué à la responsabilité individuelle (au devoir de travailler, par exemple), mais aussi à la solidarité, qui ne peut être que volontaire pour revêtir une valeur morale. Les faux droits-créances de l’État social ont dégagé la législation de la loi morale. L’idée de la redistribution de richesses par l’intermédiaire de l’État n’a d’ailleurs jamais découlé d’un souci de venir en aide, mais de ne pas perdre le contrôle sur une société civile de plus en plus autonome et prospère. Cependant, l’éthique du devoir ne s’impose pas; elle se répand par les armes libérales traditionnelles de la persuasion et de l’éducation.
En conclusion, on peut se demander dans quelle mesure les normes incarnées et défendues par Charles Monnard peuvent encore prévaloir dans nos sociétés laïques. Le premier constat est que les valeurs reçues et intériorisées demeurent toujours très influentes. Le respect de la vie et de la propriété, le sens de la responsabilité, la conscience et le goût du travail bien fait et de faire ce qui est juste sur la base de son libre arbitre, de même que les vertus de générosité et de solidarité, au sein de la famille ou de la communauté civile, n’ont rien d’inédit dans le fonctionnement harmonieux de l’économie de marché et au-delà. Cela vaut même dans le contexte international: parce qu’elles sont rationnelles, les règles humanistes sont universelles. Elles se retrouvent dans d’autres cultures et traditions et se transmettent aussi à travers la mondialisation des échanges, qui favorise l’honnêteté, la fiabilité et la règle d’or dans l’intérêt personnel bien compris sur la durée, sinon par rattachement à une éthique commune.
Publications :

INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Être tenu au courant des dernières informations
Recevoir environ une fois par mois des informations sur les publications et événements du moment.
L’Institut Libéral se réjouit d’avoir de vos nouvelles.
LIBERALES INSTITUT
Hochstrasse 38
8044 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 364 16 66
institut@libinst.ch
INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Tel.: +41 (0)21 510 32 00
liberal@libinst.ch
ISTITUTO LIBERALE
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
liberale@libinst.ch

Recevoir environ une fois par mois des informations sur les publications et événements du moment.