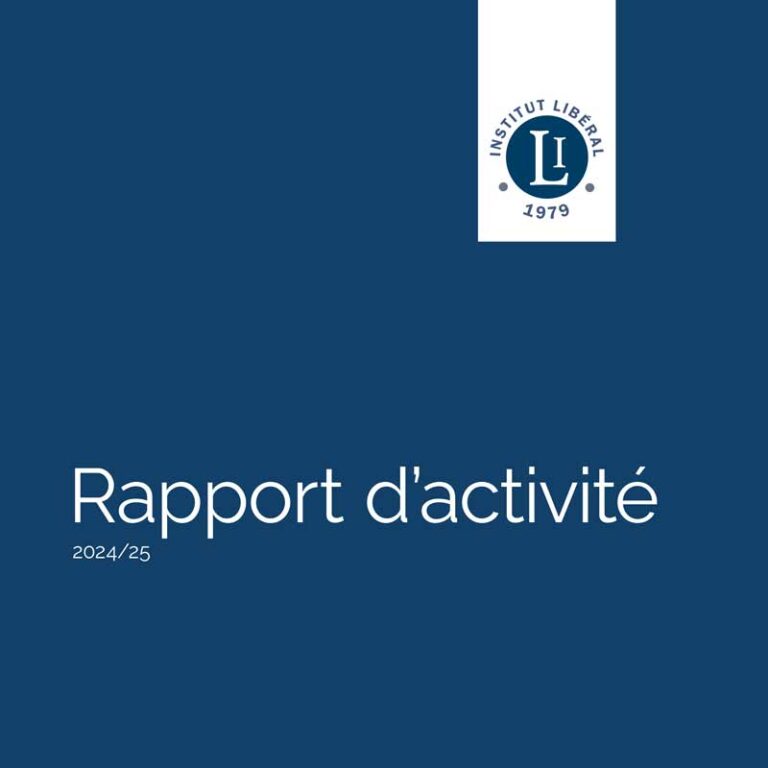À propos de l'institut

Fondé en 1979, l’Institut Libéral a pour mission la réflexion et la recherche des idées de liberté. L’Institut promeut la tradition et la culture suisses de liberté individuelle, de paix, d’ouverture et de diversité politique et contribue au développement de la tradition intellectuelle libérale. L’autonomie privée, fondée sur la propriété et l’échange dans une société civile pluraliste, sert de principe directeur. L’Institut s’engage en faveur de marchés ouverts et d’un environnement institutionnel décentralisé.
D’esprit confédéral et de rayonnement international, premier think tank indépendant du pays, l’Institut Libéral travaille en quatre langues: le français, l’allemand, l’italien et l’anglais.
Au cœur des activités de l’Institut se trouvent de nombreuses publications de livres, mais également de contributions en ligne et une variété d’événements publics et privés. L’Institut organise des programmes spécifiques pour les jeunes talents issus du monde de la politique, des sciences, du journalisme et de l’économie, comme la Liberty Summer School, qui a lieu chaque année. Il coopère dans toute la Suisse et au niveau international avec des organisations poursuivant des objectifs similaires et publie de nombreux index scientifiques, comme l’indice de liberté économique et l’indice des droits de propriété.
L’Institut remet chaque année le Prix Röpke pour la Société Civile à des personnalités qui ont contribué de façon remarquable à la culture de la liberté en Suisse. Sur son site de Zurich, l’Institut entretient une Bibliothèque de la Liberté, qui est à disposition des étudiants, chercheurs et toute autre personne intéressée.
En outre, notre think tank libéral gère les sites internet de deux économistes libéraux particulièrement influents, Roland Baader (1940-2012) et Anthony de Jasay (1925-2019).
Distinctions
- Prix du réseau de la Friedrich August von Hayek Gesellschaft (2021)
- Templeton Freedom Award de l’Atlas Economic Research Foundation (2005)
- Prix de la liberté de la Max Schmidheiny Foundation (1991)
Organisation
L'Institut Libéral est soutenu par une équipe de personnalités libérales engagées.
Direction de l'institut
Chercheurs associés
Conseil de fondation

Daniel Eisele
Avocat,
Zurich (président)

Sandro Piffaretti
Entrepreneur,
Cham (vice-président)

Victoria Curzon Price
Professeur d'économie politique, Genève

Michael Esfeld
Professeur de philosophie des sciences, Lausanne

Beat Gygi
Journaliste,
Zurich

Daniel Model
Industriel,
Weinfelden

Robert Nef
Publiciste,
St. Gallen

Henrique Schneider
Économiste,
Appenzell
Conseil académique

Richard Ebeling
Professeur d'économie, The Citadel, Charleston

Renaud Fillieule
Professeur de sociologie, Université de Lille

Pierre Garello
Professeur d'économie, Université Paul-Cézanne, Aix-en-Provence

Gabriel A. Giménez Roche
Professeur associé d'économie à NEOMA Business School

Jesús Huerta de Soto
Professeur d'économie, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid

Jörg Guido Hülsmann
Professeur d'économie, Université d'Angers
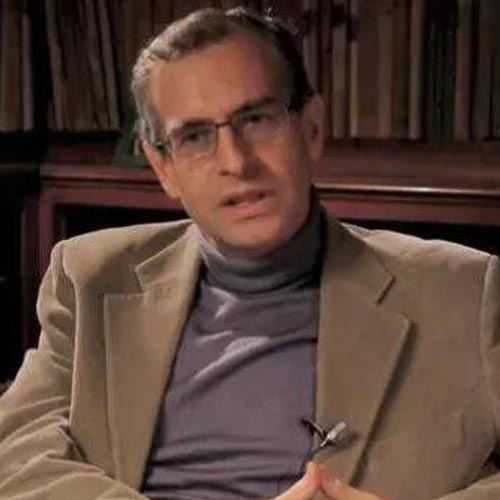
Carlo Lottieri
Professeur de philosophie, Università degli Studi di Verona

Pascal Salin
Professeur d'économie, Université Paris-Dauphine
Comité de l'Institut

Victoria Curzon Price
Professeur à l'Université, Genève (présidente)
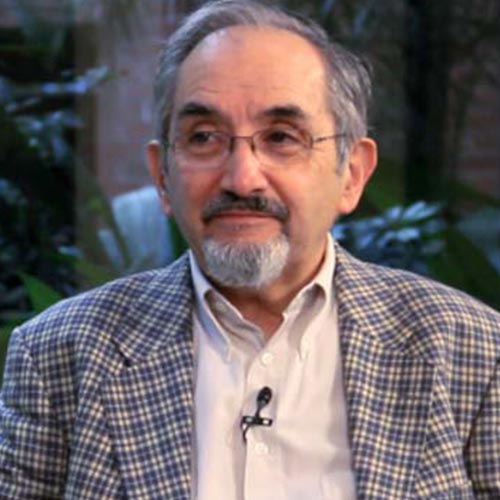
Alphonse Crespo
Médecin, Vevey (vice-président)

Axel Arnoux
Industriel, Saint-Cergue

Patricia Commun
Professeur à l'Université, Arzier

Loïc Hautier
Juriste, Lausanne

Emmanuel Garessus
Journaliste, Bâle

Frédéric Jollien
Économiste, Lausanne
Organe de révision
Marty Revision AG,
Luzern, Schweiz
La philosophie
Le libéralisme se fonde sur la primauté de la personne, de ses objectifs et de ses aspirations. Le scepticisme envers le pouvoir et la contrainte et donc envers l’État fait donc partie des préconditions d’une société libre. C’est également d’où elle tire sa vigueur.
Les libertés fondamentales sous-jacentes à un ordre libéral ne peuvent être relativisées sans mettre en péril la dignité de la personne. C’est pourquoi elles méritent notre attention particulière et notre engagement. Les bases d’un ordre libéral peuvent être décrites par les trois principes suivants.
Concevoir l'homme responsable comme origine et finalité
Un ordre libéral se caractérise par l’autonomie personnelle. Là où la contrainte a échoué, l’autonomie et les interactions sociales volontaires doivent reprendre le dessus. La responsabilité personnelle peut remplacer la force et la réglementation à travers un processus de désengagement de structures étatiques qui traduisent souvent de bonnes intentions, mais dont les incitations et les résultats sont pénalisants. La personne responsable qui mène sa vie de façon autonome, en échange avec les autres, est tant le point de départ que la finalité d’une société libre.

Elaborer des solutions aussi privées et proches des citoyens que possible
La liberté et l’autonomie de la personne ne conduisent pas à l’isolation, mais à la coopération au sein de la société civile et de l’économie de marché. L’indépendance se manifeste à travers des réseaux volontaires et contractuels. Là où prévalaient des structures centralisées, des entités locales pluralistes doivent encourager la concurrence. La centralisation politique représente un danger pour la liberté et l’autonomie de la personne. Un ordre libéral doit avoir le courage et la tolérance d’admettre la responsabilité personnelle, l’autonomie privée et la diversité qui en découle. En plus de la variété d’arrangements contractuels, la diversité de petites entités politiques ouvertes est essentielle.

Permettre une coopération volontaire
La liberté est nécessaire à une coopération et à une solidarité efficaces. La contrainte centralisée de «l’État social» doit laisser la place à l’entraide mutuelle spontanée et organisée, au sein de la société civile et de l’économie de marché. L’échange libre entre aidants et aidés correspond à la réalité d’une société civile dynamique. Lorsque la contrainte remplace la solidarité, l’harmonie entre personnes responsables est détruite.
Ces trois principes — la personne responsable, la coopération contractuelle et décentralisée, ainsi que la solidarité volontaire — représentent les grandes lignes directrices d’un ordre libéral. Ce sont aussi les principes normatifs qui sous-tendent l’activité de l’Institut Libéral.

Tradition
L’Institut Libéral se rattache à la tradition suisse de la liberté, dont les racines remontent au XIIIe siècle. À cette époque, les Confédérés avaient défendu leur indépendance face à la tyrannie fiscale et l’avaient remplacée par une communauté volontaire liée par des règles communes minimales. Cette histoire — dramatisée par le poète Friedrich Schiller et qui ralliera autour de mêmes valeurs plusieurs régions linguistiques — reflète deux constantes de l’idée de la liberté: le rejet de la contrainte et le recours aux accords contractuels.
Une idée universelle
La liberté, bien sûr, n’a pas été inventée en Suisse — elle fait partie de l’héritage culturel de l’humanité. Le scepticisme libéral envers le pouvoir est à la source de toute société paisible et pluraliste, de toute économie innovante et prospère, de la civilisation à proprement parler. Il trouve son expression dans l’idée, déjà formulée par les Israélites et les Grecs antiques, que les gouvernants doivent être soumis aux même règles morales qui prévalent pour tous et ne peuvent bénéficier légitimement d’un pouvoir absolu ou arbitraire. Le philosophe chinois Lao Tseu, souvent considéré comme l’un des premiers penseurs libéraux, avait déjà relativisé au VIe siècle av. J.C. l’importance du pouvoir dans les relations sociales et prévenu des méfaits de l’interventionnisme et d’une fiscalité excessive pour l’harmonie de la société.
Germaine de Staël et Benjamin Constant
En Suisse, l’exploration de l’idée de la liberté reçut un nouvel élan au XVIIIe siècle avec Germaine de Staël. Son salon, au château familial de Coppet, devint un lieu d’échange et de production intellectuels où les cultures allemande, anglaise, française et italienne en quête inspirée de liberté se mélangent : ce think tank avant la lettre se consacre à l’étude de la liberté sous toutes ses facettes, littéraire, philosophique, religieuse. Il fut même à un moment l’unique opposition à Napoléon, armé de la seule intelligence de son animatrice. Germaine joue un rôle de catalyseur dans l’œuvre de Benjamin Constant, l’un des philosophes politiques les plus illustres des Lumières.
ce think tank avant la lettre se consacre à l’étude de la liberté sous toutes ses facettes, littéraire, philosophique, religieuse. Il fut même à un moment l’unique opposition à Napoléon, armé de la seule intelligence de son animatrice. Germaine joue un rôle de catalyseur dans l’œuvre de Benjamin Constant, l’un des philosophes politiques les plus illustres des Lumières.  Benjamin Constant s’emploie à démystifier l’État en tant que simple association humaine, sans existence propre, destinée à protéger la liberté individuelle. Il questionne le droit des majorités d’imposer leur volonté au détriment des droits individuels et prévoit les dangers de l’action publique lorsqu’elle sort de sa sphère. Il s’engage pour la liberté de pensée et ses corollaires: la liberté économique, la liberté d’opinion et la liberté d’expression. Pacifiste rationnel, il montre que la liberté et le commerce sont des moyens plus efficaces que la violence pour s’enrichir. En sa qualité de défenseur des petites entités politiques, il met en garde contre les périls de la centralisation et fait figure de précurseur du débat actuel sur la concurrence institutionnelle.
Benjamin Constant s’emploie à démystifier l’État en tant que simple association humaine, sans existence propre, destinée à protéger la liberté individuelle. Il questionne le droit des majorités d’imposer leur volonté au détriment des droits individuels et prévoit les dangers de l’action publique lorsqu’elle sort de sa sphère. Il s’engage pour la liberté de pensée et ses corollaires: la liberté économique, la liberté d’opinion et la liberté d’expression. Pacifiste rationnel, il montre que la liberté et le commerce sont des moyens plus efficaces que la violence pour s’enrichir. En sa qualité de défenseur des petites entités politiques, il met en garde contre les périls de la centralisation et fait figure de précurseur du débat actuel sur la concurrence institutionnelle.
Ludwig von Mises, Wilhelm Röpke
 Au siècle dernier, la Suisse joue à nouveau un rôle d’oasis de liberté, durant les heures les plus sombres d’une Europe s’enfonçant de plus en plus dans le collectivisme. Ludwig von Mises En 1934, l’Institut universitaire des Hautes Études Internationales de Genève, dirigé par William Rappard, offre un refuge au grand économiste autrichien Ludwig von Mises.
Au siècle dernier, la Suisse joue à nouveau un rôle d’oasis de liberté, durant les heures les plus sombres d’une Europe s’enfonçant de plus en plus dans le collectivisme. Ludwig von Mises En 1934, l’Institut universitaire des Hautes Études Internationales de Genève, dirigé par William Rappard, offre un refuge au grand économiste autrichien Ludwig von Mises.  C’est ici qu’il écrit son œuvre maîtresse, L’Action humaineWilhelm Röpke, publiée en 1940, qui demeure un traité incontournable pour les économistes libéraux. L’économiste allemand Wilhelm Röpke arrive au même institut en 1937. Il développe à Genève sa philosophie sociale, qu’il publie dans une importante trilogie et défend l’idée de la liberté dans le débat public, notamment dans la Gazette de Lausanne.
C’est ici qu’il écrit son œuvre maîtresse, L’Action humaineWilhelm Röpke, publiée en 1940, qui demeure un traité incontournable pour les économistes libéraux. L’économiste allemand Wilhelm Röpke arrive au même institut en 1937. Il développe à Genève sa philosophie sociale, qu’il publie dans une importante trilogie et défend l’idée de la liberté dans le débat public, notamment dans la Gazette de Lausanne.
F. A. von Hayek et la Société du Mont Pèlerin
 Lorsque vient le moment, suite à deux guerres mondiales, de poser les fondations d’une renaissance de la civilisation, l’économiste, juriste et philosophe social (et plus tard lauréat Nobel) Friedrich Hayek réunit en 1947 au Mont-Pèlerin, au-dessus de Vevey, une quarantaine de savants libéraux éminents — dont Mises, Rappard et Röpke, mais aussi Milton Friedman, Bertrand de Jouvenel ou encore Karl Popper. La Société du Mont-Pèlerin inclut aujourd’hui plus de 700 penseurs et praticiens de la liberté Friedrich Hayek et demeure l’une des plateformes internationales les plus actives pour l’exploration, jamais achevée, de la liberté et de ses implications. Friedrich Hayek fut un conférencier fréquent en Suisse dans les décennies qui suivirent et y publia certains de ses essais les plus importants. Tant lui que Mises ou Röpke étaient également de profonds admirateurs des grands libéraux français du XIXe siècle, comme Frédéric Bastiat ou Alexis de Tocqueville, qui avaient énoncé de façon remarquable les principes d’une société libre.
L’Institut Libéral promeut cette tradition intellectuelle et humaniste de la liberté depuis 1979 et s’est donné pour mission de continuer à en porter le flambeau au XXIe siècle.
Lorsque vient le moment, suite à deux guerres mondiales, de poser les fondations d’une renaissance de la civilisation, l’économiste, juriste et philosophe social (et plus tard lauréat Nobel) Friedrich Hayek réunit en 1947 au Mont-Pèlerin, au-dessus de Vevey, une quarantaine de savants libéraux éminents — dont Mises, Rappard et Röpke, mais aussi Milton Friedman, Bertrand de Jouvenel ou encore Karl Popper. La Société du Mont-Pèlerin inclut aujourd’hui plus de 700 penseurs et praticiens de la liberté Friedrich Hayek et demeure l’une des plateformes internationales les plus actives pour l’exploration, jamais achevée, de la liberté et de ses implications. Friedrich Hayek fut un conférencier fréquent en Suisse dans les décennies qui suivirent et y publia certains de ses essais les plus importants. Tant lui que Mises ou Röpke étaient également de profonds admirateurs des grands libéraux français du XIXe siècle, comme Frédéric Bastiat ou Alexis de Tocqueville, qui avaient énoncé de façon remarquable les principes d’une société libre.
L’Institut Libéral promeut cette tradition intellectuelle et humaniste de la liberté depuis 1979 et s’est donné pour mission de continuer à en porter le flambeau au XXIe siècle. Prix Röpke pour la société civile
Le Prix Röpke pour la Société Civile est la reconnaissance d’accomplissements et d’un état d’esprit en consonance avec les préoccupations du grand économiste et de l’Institut Libéral. Nous souhaitons de cette manière également manifester notre gratitude et célébrer la vivacité et la pluralité de la culture libérale en Suisse. Le Prix Röpke est décerné chaque année.
Prix Röpke pour la société civile
L’économiste et philosophe Wilhelm Röpke (1899-1966) fait partie des plus importants représentants du libéralisme de l’histoire récente de la Suisse. Dans le cadre de son activité de professeur à l’Institut Universitaire des Hautes Études Internationales de Genève, ainsi que de ses nombreux livres, publications et articles d’opinion dans la presse suisse, il a défendu de façon engagée et éloquente la liberté individuelle, l’économie de marché et un ordre institutionnel décentralisé. Ceci à une époque où beaucoup de ses contemporains sympathisaient avec des idéologies totalitaires ou préconisaient un alignement par «pragmatisme» sur les sophismes en vogue.
Wilhelm Röpke symbolise encore aujourd’hui le courage, l’amour de la liberté et la créativité dissidente. D’après Röpke, le maintien d’un ordre libre et d’une société civile dynamique exige que chaque citoyen individuel applique et respecte des valeurs et des normes libérales dans la vie de tous les jours. Avec le Prix Röpke pour la Société Civile, l’Institut Libéral récompense des personnalités de l’économie, de la science et de la culture qui, par leurs activités, ont renforcé la présence des idéaux de liberté dans la société.
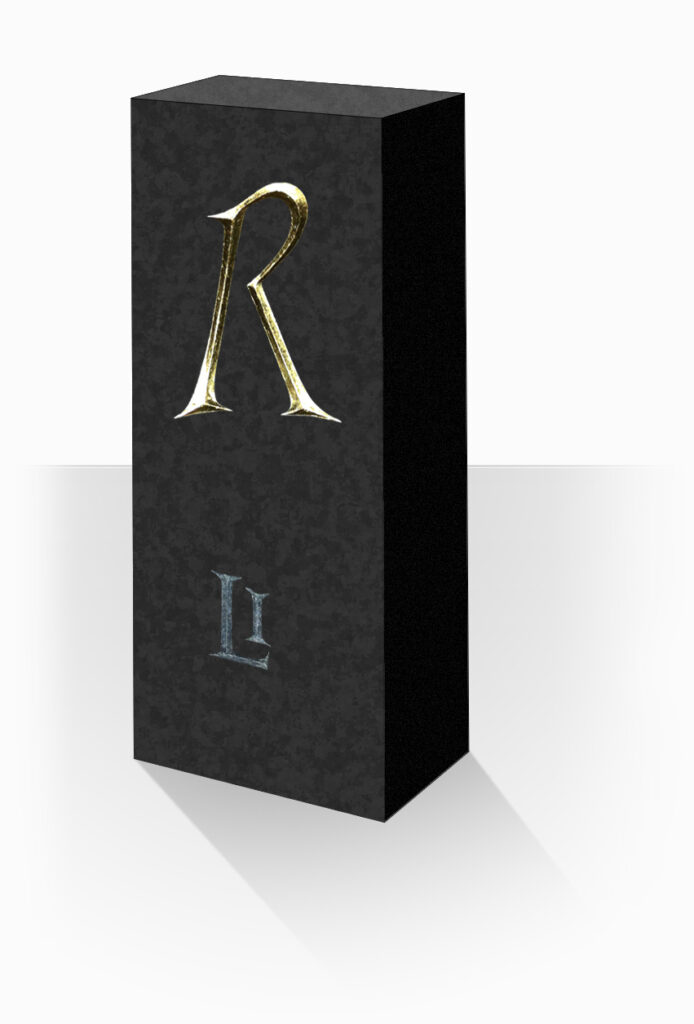
Parmi les précédents lauréats du Prix Röpke pour la société civile, on peut citer
Javier Milei
Pour son rôle de pionnier international dans la lutte contre la démesure étatique.
Discours du lauréat « Les succès des réformes libérales en Argentine »
Kaspar Villiger
Pour son précieux engagement en faveur de la mise en place d’un frein à l’endettement étatique
Discours du lauréat «L’Etat de droit libéral et démocratique en tant qu’acquis»
Suzette Sandoz
pour leur engagement de longue date et intrépide en faveur de la cause libérale dans un climat d’opinion étatiste
Discours du lauréat : «Hat der Neoliberalismus den Liberalismus beseitigt?»
Dominik Feusi
pour sa contribution au maintien d’une culture du débat et son travail journalistique résolument attaché aux valeurs libérales
Werner Widmer
pour sa contribution à la valorisation de la responsabilité individuelle dans le secteur de la santé
Discours écrit du gagnant du prix (en allemand) : «La santé et la responsabilité».
Le discours est également disponible ici sous format vidéo (en allemand).
Gerhard Schwarz
pour ses propositions de réformes tournées vers l’avenir, qui tiennent compte des atouts institutionnels de la Suisse
Vidéo de la cérémonie de remise des prix
Tobias Straumann
pour sa communication concrète des contextes économiques et des fondements commerciaux de la prospérité
Article de Tobias Straumann
Martin Lendi
pour sa contribution à une culture vivante du droit en tant que principe d’une coexistence pacifique et prospère
Discours de Martin Lendi
Franz Jaeger
pour ses contributions scientifiques en faveur d’un ordre décentralisé et d’une politique économique raisonnable
Interview avec Franz Jaeger
Andreas Oplatka
pour ses publications de grande qualité, résolument orientées en faveur de la liberté
Discours d’Andreas Oplatka
Victoria Curzon Price
pour sa défense de la concurrence fiscale et réglementaire internationale ainsi qu’un fédéralisme compétitif
Discours de Victoria Curzon Price
Peter Bernholz
pour son engagement infatigable en faveur de la liberté individuelle et de l’État de droit
Rapport de Peter Bernholz
Charles Blankart
pour avoir contribué à une participation constructive de la science au débat public et à la clarification des politiques économiques
Discours de Charles Blankart
Bruno Frey
pour ses travaux sur les conséquences de la centralisation dans le contexte européen
Article de Bruno Frey
Beat Kappeler
pour son engagement en faveur d’une éthique de la responsabilité individuelle et contre la mise sous tutelle de l’État social
Discours de Beat Kappeler
Karl Reichmuth
pour son engagement en faveur d’un système monétaire sain et contre les effets de l’inflation
Discours de Karl Reichmuth