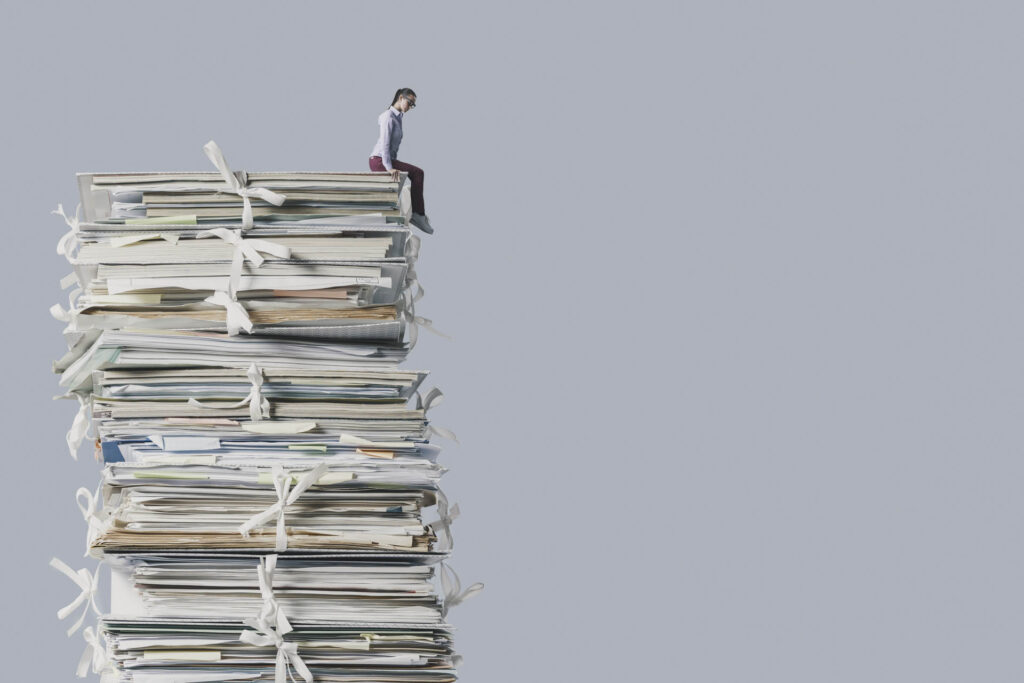
L’économiste allemand Wilhelm Röpke (1899-1966), critique du régime nazi dès les années 1930, avait été contraint à l’exil à Istanbul où il contribua à l’édification d’une université résolument moderne. C’est en 1937 qu’il fut engagé par William Rappard à l’Institut des Hautes études internationales, à Genève. Il y enseigna jusqu’à sa mort en 1966 et s’y consacra également à l’écriture et à la recherche.
L’influence de Wilhelm Röpke sur la pensée libérale de son époque a été considérable, et elle est largement sous-estimée par nos contemporains. Il a figuré au sein des amis les plus proches de Konrad Adenauer et Ludwig Erhard et a largement contribué, dans l’après-guerre, à la sortie d’une économie de guerre entièrement centralisée et à sa transformation en économie sociale de marché. En Suisse, les innombrables articles de Röpke, publiés dans la Neue Zürcher Zeitung, le Journal de Genève et la Gazette de Lausanne a conforté dans ses choix, au sein des libéraux, la «génération du service actif», laquelle s’en est largement inspirée dans ses décisions politiques. Röpke lui-même admirait la tradition de liberté chère à notre pays, qu’il a d’ailleurs contribué à vivifier. Lorsqu’en 1941 ses collègues allemands de Genève émigrèrent aux Etats-Unis par peur d’une invasion allemande, il resta fidèle à Genève, son nouveau lieu de travail et de résidence. Même après la guerre, il refusa de revenir en Allemagne.
Après 1945, l’économie suisse se trouvait à la croisée des chemins. L’industrie d’exportation et les activités de services internationaux avaient cédé beaucoup de terrain à l’économie domestique. Devait-elle poursuivre sur la voie protectionniste ou faire confiance au libre-échange et à la division internationale du travail? Röpke appartint, avec l’influent genevois William Rappard et le professeur de droit public zurichois Zacharie Giacometti, aux pionniers de l’offensive libérale. Il plaida pour l’abaissement rapide du dirigisme et l’édification d’une économie de libre-échange en tant que fondement d’une société civile antitotalitaire et antisocialiste.
Pour Röpke, l’économie n’était pas une science dépourvue de valeurs, mais partie intégrante d’une société fondée sur une éthique «au-delà de l’offre et de la demande» (le titre de l’un de ses ouvrages). Son œuvre et ses écrits genevois, publiés en anglais et en français, s’inscrivent dans la philosophie de la culture et appartiennent à la communauté libre des hommes libres.
Le point de départ de sa pensée est centré sur la famille et sur un Etat fédéral fondé sur le principe de subsidiarité. La Suisse était un exemple pour ce Genevois d’adoption. C’est en se fondant sur la famille puis les communes, districts, cantons et pays qu’il fallait créer, dans l’Europe de l’après-guerre, des structures fédérales et non centralisées.
Bien que l’esprit de Wilhelm Röpke ait laissé des traces dans la politique suisse jusqu’à aujourd’hui, son libéralisme a été progressivement remplacé dans les années 1970 par une génération de politiciens qui, sans guère de considérations critiques, s’est accommodée et même parfois «arrangée» avec l’Etat social et paternaliste tant critiqué par Röpke.
Röpke appartenait aux premiers critiques d’une communauté européenne placée sous la bannière d’une politique centralisée. Cette position anticentraliste, qui paraît aujourd’hui plus atemporelle que dans les années 1970 et 1980, a contribué à le qualifier de conservateur libéral et empêché l’adoption ultérieure de ses idées pourtant très prometteuses.
La génération de 1968 a exigé la primauté de la politique et un soutien politique aux rêves d’épanouissement collectifs. Elle attendait le progrès d’un surcroît de solidarité forcée, de politique économique et sociale centralisée et d’une adhésion à l’UE. Face à ses postulats puissamment soutenus par la très grande majorité des médias, les partis bourgeois ont partiellement péché par leur souci d’adaptation et par leur passivité. On était plutôt éloigné des valeurs défendues par Röpke.
Röpke a dénoncé sans relâche dans l’histoire des idées la fatale coalition des libéraux avec les centralistes et les nationalistes, qui s’est également produite en Suisse lors de la création de l’Etat fédéral. Dans son livre La question allemande, il condamnait la collaboration libérale avec les centralistes comme une atteinte à la liberté, à la diversité et à l’individualisme. Dans tous les cas, ses réflexions étaient plus proches du fédéralisme des libéraux suisses romands que des avocats d’un gouvernement central fort.
Wilhelm Röpke a, dans ses réponses aux défis de son époque, donné un élan au libéralisme à travers ses innombrables écrits. Leur influence s’est prolongée jusqu’à nous et elle gagne même en actualité. Il est à souhaiter qu’on poursuive davantage sa critique fondamentale de la société de masse et de l’Etat paternaliste, redistributeur et source de dettes.
Robert Nef est membre du conseil d’administration de l’Institut Constant de Rebecque. Une version de cet article a été publiée dans Le Temps.

INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Être tenu au courant des dernières informations
Recevoir environ une fois par mois des informations sur les publications et événements du moment.
L’Institut Libéral se réjouit d’avoir de vos nouvelles.
LIBERALES INSTITUT
Hochstrasse 38
8044 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 364 16 66
institut@libinst.ch
INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Tel.: +41 (0)21 510 32 00
liberal@libinst.ch
ISTITUTO LIBERALE
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
liberale@libinst.ch

Recevoir environ une fois par mois des informations sur les publications et événements du moment.